Mémoire chaude et mémoire froide à propos de la crasse, du laser et de son jaune.
Il y a la mémoire chaude, celle de la vie intérieure.
Elle concerne les ressentis, les émotions esthétiques et affectives. On y trouve l’enthousiasme et la rancœur, l’humiliation, les petites lâchetés comme le courage. Mais aussi l’étonnement, l’estime, la reconnaissance, parfois l’admiration, l’amitié.
En font aussi partie les silences, les non-dits, les non-réponses dont on parlera plus loin.
Il y a beaucoup de mémoire chaude chez les restaurateurs.
L’autre partie de la mémoire, la froide, est celle qui se trouve dans les documents d’archives et les bibliothèques, hors courriers personnels : les documents comptables, les dossiers d’appels d’offres, les rapports de restauration, les décisions administratives, les publications scientifiques, résultats de longs, sérieux et coûteux travaux, en y incluant les travaux universitaires, même ceux de sciences dites « dures ».

Dans leur travail de préservation du patrimoine les conservateurs et les scientifiques concernés font plus appel à la partie froide de la mémoire, même si individuellement ils possèdent autant de mémoire chaude que quiconque.
La mémoire chaude se nourrit plus de la froide que l’inverse.
Le laser de nettoyage. 1) mémoire froide.
On peut trouver dans la littérature quantité d’ouvrages ou d’articles ayant trait à la dégradation et à la restauration des pierres mises en œuvre, sculptées ou non, à la nature physico-chimique de tous les dépôts naturels ou artificiels (aérosols, poussières...) qui les recouvrent peu à peu. Ces dépôts transforment le matériau en surface puis en profondeur, par interaction avec lui.
On trouve aussi dans les services d’archives ou de documentation patrimoniale un nombre très important de rapports d’intervention ou d’étude de restaurateurs, de DOE (dossier des ouvrages exécutés) des architectes.
On a ainsi accès à tout ce qui a trait à la technique du laser exploitée à des fins patrimoniales, comme outil servant à l’analyse mais plus encore au nettoyage. On devrait d’ailleurs plutôt parler des lasers au pluriel. On s’en tiendra ici au singulier par commodité, et, pour être précis, au laser à impulsion (Q-switched Nd-YAg) utilisé ces dernières 25 années sur les chantiers et dans les ateliers.
En France l’aventure technique commença en 1992, sous l’impulsion déterminante du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH), avec la construction d’un prototype de chantier, laser de nettoyage bien spécifique rendue possible par l’investissement financier d’une dizaine de grosses entreprises de restauration de monuments.
Ses avantages étaient (et sont encore) incomparables, le plus important pour la conservation du patrimoine étant celui de l’innocuité de l’action du rayon sur le matériau : la pierre calcaire claire en général, mais aussi sur le marbre, le plâtre… en fait à peu près tous les matériaux minéraux clairs. Le très bref rayon (ici infra-rouge) pénètre dans l’encrassement sombre en quelques milliardièmes de seconde, le fait « exploser » puis dès l’apparition de la couleur plus claire sous-jacente « rebondit » et n’agit plus, malgré son énorme puissance. On a donc un autocontrôle réalisé par la technique elle-même, pourvu que l’énergie moyenne choisie soit la bonne.
Ces mots sont bien sûr très imagés quand on connait la complexité tant du phénomène du rayon laser que son impact sur de la matière.


Un « tour de France du laser » fut organisé en 1993-94 par le LRMH, où des tests furent réalisés sur bon nombre de monuments. Ayant fait part de mon grand intérêt pour cette nouvelle technique, on me confia des essais à réaliser sur le portail sculpté du transept nord de la basilique Saint Denis en juin 1993, puis d’autres essais en octobre sur un contrefort du mur gouttereau sud. On me confia aussi en mars 1994 des tests sur les sculptures des portails de Notre-Dame de Paris.
Toujours très intéressé et continuant à le faisant savoir, on me confia alors avec Didier Groux (qui avait fait les essais sur la sculpture extérieure de la cathédrale d’Amiens) une partie de la formation d’autres restaurateurs, qui eut lieu au LRMH.

Plus que passionné je commençais à maîtriser cette technique, et ne rencontrais pas de difficultés à l’employer sur de nombreuses œuvres de musées durant ces années 1993-1994, particulièrement aux musées de Cambrai et de Douai, dont la conservatrice, F. Balimitaine, fit tout pour que ces travaux d’un genre assez particulier se déroulent dans de bonnes conditions.
Le laser de nettoyage, 2) mémoire chaude
« C’est jaune ton truc »
A Saint-Denis dès les premières minutes d’utilisation je m’étais rendu compte d’un rendu jaunâtre particulier sur la pierre après nettoyage, pouvant varier d’un ocre léger et assez doux à un orange plus soutenu. Je pouvais, sans trop de forfanterie, considérer que je possédais déjà un œil bien formé à l’aspect d’une pierre altérée ou non et là je ne voyais pas, ne « sentais » pas cette couleur comme celle d’une pierre ayant vieilli en extérieur. C’était une autre couleur.
On sait qu’avec le temps les caractéristiques de l’épiderme d’une pierre en extérieur se sont transformées avec le temps, en raison d’interactions avec l’environnement. On sait aussi que ces transformations modifient la couleur de la surface, aboutissant à celle d’une « patine », terme à consonance plutôt esthétique extrêmement vague dont on dit parfois qu’elle est la marque du temps.
Mais si le mot est vague, la modification de couleur est bien réelle et correspond à des modifications parfaitement étudiées et connues scientifiquement. Mais là c’était différent.
Je fis alors un test sur l’échafaudage dans les minutes qui suivirent : je déposais de l’encrassement réduit en poudre lié par de l’eau sur un fragment de pierre saine, blanche : la surface de celle-ci devint légèrement jaune après l’action du rayon et donc la dispersion de l’encrassement.
Le lendemain je refis le test sur du plâtre propre, l’ayant seulement sali au crayon de graphite : toujours ce léger jaune après passage du rayon, de même que sur du papier crayonné de noir.
Un collègue à l’œil sûr vint me voir à Saint Denis pour voir enfin cette fameuse machine. Le nettoyage était à peine commencé qu’il me dit : « c’est jaune ton truc ! ». J’étais rassuré, je n’étais pas le seul à constater le phénomène.
Je fis bien sûr part de mes observations au LRMH, qui m’écouta, mais sans donner suite, niant le phénomène, à mon grand étonnement : comment peut-on, surtout de la part de scientifiques, nier un phénomène aussi visible ? Cette attitude aveugle (le comble à propos d’un phénomène optique) fut-elle consciente ou non ? Il n’était assurément pas bon pour un restaurateur d’émettre des doutes sur le caractère exceptionnel (et presque miraculeux) de cette nouvelle technique. Et donc de remettre en cause un vaste programme de recherche. De quoi me mêlais-je donc, moi le restaurateur ?
Non seulement cette technique avancée m’intéressait beaucoup, en raison sans doute de mes connaissances scientifiques de base acquises en prépa, mais je me trouvais de plus confronté à une situation particulière : je souhaitais défendre une technique dont j’appréciais les grands mérites, tout en devant m’opposer sur un point important à un laboratoire d’Etat , moi restaurateur indépendant isolé, sans soutien d’aucune structure.
Je fis les mêmes constatations à propos du jaunissement sur un nombre non négligeable d’œuvres de musées (Cambrai, Dijon, Douai). Cette coloration jaune apparaissait autant sur les sculptures en pierre ayant vieilli en extérieur que sur celles simplement salies par la poussière de musée. Il en était de même avec les plâtres simplement crasseux qui devinrent après nettoyage pourvus d’une douce couleur ivoire.

Cela commençait à devenir gênant : utiliser une technique entraînant une coloration étrangère sur tout type de sculpture sale en pierre, marbre ou plâtre n’était pas conforme à un de nos objectifs de conservation-restauration, à savoir ne pas transformer l’aspect d’une œuvre d’art ancienne en raison de nos actes modernes. Ceci en lui imposant une couleur de surface sans rapport avec le matériau d’origine ou son histoire matérielle.
Je finis (en mars 1994) par faire un courrier très détaillé et descriptif à la direction du LRMH, avec copie à la direction du Service de Restauration des musées de France. (Ce courrier est reproduit en annexe à la fin de la thèse de doctorat sur ce sujet du jaunissement, soutenue récemment par M. Godet).
25 ans après, j’attends toujours la réponse. Le silence de l’administration, le manque de prise au sérieux d’une telle alerte eurent deux conséquences néfastes : un sentiment d’humiliation chez moi par manque de reconnaissance professionnelle, la non prise en compte du phénomène d’un point de vue scientifique et la perte d’une dizaine d’années de recherche dans ce sens.
Je mets le paquet
Je compris que, quoique je fasse, je ne serais pas écouté. Je voyais bien autour de moi que beaucoup (restaurateurs comme conservateurs ou même architectes) s’accordaient pour constater ce jaunissement, et pourtant rien ne se passait au LRMH durant ces années 1990.
Les connaissances scientifiques de base acquises dans ma jeunesse pouvaient m’aider, au moins dans la familiarité des concepts et de la description des phénomènes physiques : par le biais d’équivalences je m’inscrivis à une formation spécifique sur le laser à l’Institut d’Optique (à Palaiseau). J’eus droit à une semaine d’équations, de formules et de schémas. Je me retrouvais dans une école d’ingénieurs, 20 ans après mon départ volontaire et rapide de Centrale Lille. C’était étrange.
Cela ne fut pas très utile pour mon métier de restaurateur, mais j’avais atteint mon objectif qui était celui d’une familiarisation avec le phénomène physique du laser et son vocabulaire.
Le premier congrès LACONA, spécifiquement consacré à l’utilisation du LAser pour la CONservation d’œuvres d’Art, eut lieu en 1995 en Crête, à Héraklion. Je m'y rendis comme participant non intervenant : la perspective de lier le travail avec la visite d’Athènes et de Cnossos était trop alléchante.
S’il n’y avait aucun restaurateur français, j’y rencontrai par contre l’ensemble des scientifiques du LRMH ! Avec qui j’avais et j’ai encore des liens professionnels très corrects et très courtois. Quelle ne fut pas ma surprise quand j’appris que ces scientifiques (pétrographe, microbiologiste..) n’avaient pas reçu de formation théorique sur le laser semblable à celle que j’avais eue à Palaiseau ! C’était le monde à l’envers. Mon opinion sur le jaunissement n’était pas plus prise en compte pour cela.
Quelques années passèrent sans changement notable. Je continuais à utiliser cette technique, la promouvoir même : j’avais désormais (en 1999) en charge son enseignement et son apprentissage au Département restaurateurs de l’INP (cela jusqu’en 2011). Je montrais surtout aux étudiants la multiplicité des situations, parmi lesquelles le phénomène du jaunissement, paramètre à prendre en compte en toute connaissance de cause parmi beaucoup d’autres.
Il en était de même pour les surfaces recouvertes de polychromie, qui, suivant leur nature et le diagnostic une fois établi, pouvaient ou non être nettoyées avec le laser (à très faible énergie). Le plus souvent non, d’ailleurs. J’y reviendrai par la suite dans ce blog.
Au congrès LACONA IV de Paris (2001, publié en 2003), je n’hésitais pas à me fendre d’un poster exposant mon point de vue.
J’écrivis aussi à l’occasion de ce congrès un article « Is there specific laser esthetic ? » à propos de l’acceptation esthétique de cette teinte jaune induite par la technique.
Pour appuyer encore plus mes observations, j’avais déjà écrit un article à propos du nettoyage des plâtres par laser (publié en 2001), où la coloration jaune induite et artificielle est encore plus évidente.
Le balancier redescend, et remonte de l’autre côté
Mais les choses commençaient à bouger : de plus en plus de personnes (architectes, conservateurs, et bien sûr restaurateurs) percevaient cette réalité bien problématique. Ils ne souhaitaient plus utiliser le laser et revenaient à l'ancienne technique de la microabrasion (appelée abusivement microgommage), bien plus nocive pour la pierre, mais qui ne provoque pas de couleur artificielle.
Il faut dire que l’on avait parfois des résultats absurdes, que je montrais aux étudiants dès 1999 : sur un même portail on pouvait avoir (et on a encore) une trichromie artificielle, résultat de trois techniques différentes, comme à Amiens : façade (et statuaire extérieure, voir photo) plutôt blanche et froide obtenue par lessivage et microabrasion de l’épiderme des parements (seule technique économiquement possible), statuaire intérieure (voir photo) à la couleur jaune/orangé due à la technique du laser, visages gris et assez illisible car à peine nettoyés par microabrasion en raison de traces de polychromie (et pour cela impossible à nettoyer par laser).
Sur la photo, la différence de couleur sur la statuaire est donc due à des techniques de nettoyage différentes, et non à d'autres facteurs (nature de pierre...)


La non-utilisation du laser dans les années 2000 allait correspondre à un mouvement de balancier inévitable, qui aurait pu être évité si l’acceptation de cette coloration induite avait faite dès le départ. Il est possible que ma ténacité à ne pas occulter ce phénomène du jaunissement et à en parler eut une petite influence.
Rééquilibrage et rancoeur
Le LRMH, si réticent au départ, aborda cette problématique juste au moment où les professionnels de la restauration commençaient à refuser la technique. C’était donc absurde. Ce fut la rigoureuse V. Vergès-Belmin du LRMH qui, au congrès LACONA IV de Paris (2001), rédigea un article sur la réalité ou le mythe du jaunissement, commençant à pencher pour la première solution. Ce fut elle qui m’encouragea à exposer mon opinion dans un article pour le même congrès sur l’esthétique induite par ce jaunissement. Ce fut enfin elle qui depuis encouragea les recherches pour aboutir à une excellente thèse sur le sujet, récemment soutenue par M. Godet. On sait désormais bien plus de quoi il retourne scientifiquement.
Il aura fallu 25 ans !
Mais tenace est ma rancœur, à mon corps défendant.
Il reste de cette histoire qu’un phénomène, si évident soit-il mais constaté par un restaurateur ne vaut rien face à la Vérité énoncée par un « laboratoire », d’Etat qui plus est.
Cette négation eut aussi quelques petites conséquences personnelles malheureuses dont la suivante est anecdotique mais révélatrice.
Au début des années 2000 arriva à la filière sculpture du C2RMF C. Bobinotte, conservateur prétentieux, autoritaire, à l’intelligence technocratique, qui n’avait évidemment aucune expérience dans cette technique du laser. Personne de pouvoir il croyait ainsi détenir le savoir, et s’en tenait à l’opinion toute faite, « institutionnelle », comme quoi le jaune laser n’existait pas. C’est ce qu’il écrivit bêtement dans un article toujours pour le même congrès LACONA de Paris, se réclamant de V. Verges-Belmin qui commençait justement à dire le contraire. C’était ridicule.
C. Bobinotte m’obligea à louer un laser (à grands frais) pour un nettoyage de plâtre dans un musée du nord. Je lui parlai du jaunissement, de mon expérience, mais rien n’y fit.
- Non, Jean, je vous demande (ordonne) d’essayer.
Dit-il d’un ton péremptoire n’acceptant aucune contradiction.
M’opposer à cette personne influente, refuser m’exposait à de graves problèmes de travail pour les années suivantes. Une fois le laser installé devant la sculpture en plâtre, blanche à l'origine et fort sale à ce moment-là, je fis mes petits essais et les montrai au conservateur du musée en question, B. Beaunénez, qui vit tout de suite le jaunissement et refusa évidemment que j’utilise cette technique.
C. Bobinotte, j’ai bien sûr engagé des gros frais (la location d’un laser est très coûteuse) et du temps pour cette opération inutile, mais ce n’est pas le plus important. J’aimerais surtout que vous vous excusiez ou au moins regrettiez votre autorité si mal employée. N’ayez crainte, vous ne décherriez pas de votre piédestal de conservateur général directeur de grand établissement !
Toute l’expérience acquise depuis une dizaine d’années avait été balayée d’un revers de main. Mépris pour mon métier, ignorance de mon expérience, humiliation personnelle par l’obligation de courber l’échine.
La mémoire froide ignore ces choses-là, et la mémoire chaude ne contient pas que des bons souvenirs.
Mais, bon, c’est monnaie courante chez les restaurateurs de collections publiques.






































































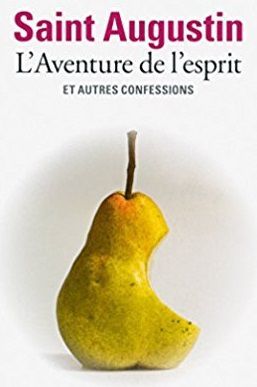






/image%2F1564119%2F20160131%2Fob_a5e689_68.JPG)